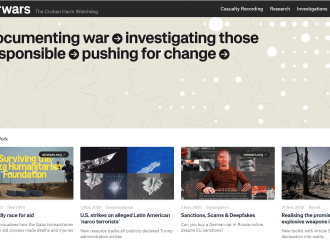Le gouvernement canadien planche depuis plus d’un an sur la façon de gérer la relation du Canada avec la Chine. C’est une réflexion salutaire si ce n’est qu’elle est obérée par une situation exceptionnelle, à savoir, l’affaire Meng Wanzhou, directrice financière de Huwei et fille du PDG du groupe, arrêtée à la demande des États-Unis en vertu de notre accord bilatéral d’extradition, et les arrestations subséquentes par la Chine des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor.
Bien que nous soyons tous commotionnés par ces événements, ce ne peut-être le point de départ de l’analyse. La Chine a évolué à une telle vitesse qu’il faut partir d’une étude dépassionnée de ses objectifs et de l’impact des efforts en vue de les réaliser sur les intérêts canadiens, à court terme à cause de Kovrig et Spavor mais surtout à long terme pour déterminer comment réaliser au mieux nos propres intérêts dans cette relation éminemment inégale… mais quand même moins inégale que celle qui marque les rapports canado-américains.
Pour ce faire, il faut avoir une appréciation claire des objectifs à long terme de la Chine, sans porter un jugement de valeur qui ne peut intervenir qu’au moment d’aborder nos propres intérêts. Il est clair que la Chine a d’immenses ambitions, marquées par une perspective à long terme. L’omniprésence militaire américaine dans la région que la Chine considère comme sa « mer intérieure » – mer de Chine septentrionale et orientale – est le point névralgique de toute sa stratégie militaire et surtout navale. Cette stratégie est axée sur le remplacement des États-Unis comme puissance dominante, par tous les moyens, exerçant la politique du bâton et de la carotte avec les pays de la région, comme les Philippines de Duterte, confirmant son rôle de partenaire numéro un de tous ses voisins asiatiques, encourageant l’avènement de régimes antidémocratiques, plus au diapason du leur. Ce faisant, la Chine cherche, surtout depuis la crise de 2008, à dévaloriser le système économico-social occidental. Mais la Chine ne veut pas d’une confrontation avec les États-Unis. Bien mieux, elle cherche à tourner à son avantage les institutions créées depuis 1945, quitte à les dénaturer à son avantage. Comparée à la Russie, puissance nucléaire mais naine économique, la Chine est une puissance infiniment plus conséquente et il faut en tenir compte, surtout nous Canadiens, voisins des États-Unis.
Il est clair que la Chine a d’immenses ambitions, marquées par une perspective à long terme.
Depuis l’accession de Donald Trump à la présidence américaine, les relations sino-américaines ont connu des aspérités étonnantes avec les girations propres à la personnalité de Donald Trump mais là aussi, se pose la question du cadre conceptuel qui devrait régir leur avenir. Pour les États-Unis, puissance mondiale dominante pour encore au moins une décennie, l’enjeu fondamental dans une relation antagoniste consiste, de part et d’autre, à une compréhension mutuelle des intérêts fondamentaux de chaque partie et, sinon de les accepter tels quels, de les respecter, afin d’éviter des mésaventures ou des accidents graves. L’exemple le plus probant en cette matière a été la crise des missiles à Cuba en 1962 alors que Nikita Khrouchtchev prit le risque de faire face à une riposte massive, voire, nucléaire, de la part des États-Unis.
Pour le Canada, la situation est plus complexe en raison de l’inégalité du rapport de forces. Mais cela n’exclut pas de définir, sans tergiverser, nos intérêts stratégiques et de les énoncer dans la clarté, sans ambiguïté. Ce n’est pas si compliqué : notre relation primordiale est celle avec les États-Unis. Évidemment, cette relation était plus facile à gérer avec des présidents « normaux » mais cela n’empêche pas d’y arriver avec un Trump, comme on l’a fait avec le renouvellement de l’ALENA. Mais la relation avec la Chine est, globalement, la deuxième en importance. Il ne s’agit pas de jongler entre les deux mais d’être clair. Nous ne pouvons pas nous permettre des fautes de jugement ou, pire, d’inattention, comme dans l’affaire Meng/Huawei, très mal gérée et qu’on aurait pu éviter dès le départ par un examen juridique plus rigoureux de la cause avant de nous plier devant la requête en extradition. Il nous faut un système d’alerte plus sophistiqué avec un mécanisme accéléré de consultation interministérielle avant de prendre une décision. Quand on a un partenaire comme la Chine avec toutes les différences fondamentales, politiques, idéologiques, institutionnelles, réglementaires et socioéconomiques, on se doit d’instituer un mécanisme de consultation d’urgence à haut niveau, formel ou informel, avec accès direct au ministre des Affaires étrangères et au bureau du Premier ministre, qui coupe à travers les rouages traditionnels et les silos décisionnels.
Recommandé: China’s Coronavirus Victory?
La distinction entre la relation avec les États-Unis et celle avec la Chine est une question de densité. Avec cette dernière, seules les relations commerciales sont déterminantes même si elles s’inscrivent dans un contexte géopolitique spécifique au titre de nos relations de défense avec les États-Unis et au sein de l’Alliance atlantique et notre acceptation conséquente d’une relation antinomique avec notre deuxième partenaire commercial. Nous avons beau dire que nous avons, à Toronto, une des plus belles collections d’art ancien chinois, les relations culturelles avec la Chine, même avant l’affaire Meng, n’étaient pas encore au diapason des relations culturelles traditionnelles transatlantiques ou nord-sud, même si le chinois est devenu la troisième langue parlée au pays. Même au plan touristique, cela ne fait que peu d’années que le Canada est devenu un pays de destination privilégiée pour les Chinois. Sur le plan des investissements privés, des barrières légitimes existent encore de part et d’autre, bien que les nôtres soient plus idéologiques et les leurs plus axées sur le contrôle et la propriété intellectuelle. D’ailleurs, le clivage idéologique est en définitive ce qui déterminera ou non l’intensification de nos relations, tout comme la mesure dans laquelle la Chine parviendra à transformer le système international à son avantage, par des initiatives comme « la Ceinture et la Route » et la politique martelée de pénétration des marchés des pays tiers, notamment en Afrique mais aussi en Amérique latine (500 milliards de dollars d’investissement dans les dix prochaines années).
Donc, pour le Canada, il s’agira d’avoir toujours une voie d’évitement diplomatique ou autre pour éviter toute confrontation au titre de nos intérêts nationaux respectifs. L’affaire Meng en est l’exemple parfait et il aurait été juridiquement plus facile d’expliquer aux Américains pourquoi nous ne pourrions pas procéder à l’extradition. En revanche, une chose à mettre au crédit du Premier ministre c’est d’avoir évité d’enflammer outre mesure la crise tout en se portant à la défense de Kovrig et Spavor. Contrairement à la plupart de nos collègues du G-7 et du G-20, le Canada ne s’empêtre que rarement dans des questions de prestige national. Une victoire au hockey contre les Russes ou les Américains nous suffit généralement. Mais plus globalement – le mot est choisi à dessein – là où le Canada a davantage d’intérêt à faire œuvre commune avec un pays comme la Chine, c’est sur les grands enjeux des maux sans frontières, comme nous l’avons fait avec le COVID-19, n’emboitant pas l’exemple américain de la fermeture de nos frontières. On songe évidemment à l’environnement sur lequel la Chine fait plus que bien d’autres pays tant qu’on ne lui impose pas des normes, ou encore sur des questions de sécurité internationales où nos intérêts concordent, comme la non-prolifération nucléaire, le désarmement ou le contrôle des armes, ou même la réalisation commune des Objectifs de développement durable.
Donc, pour le Canada, il s’agira d’avoir toujours une voie d’évitement diplomatique ou autre pour éviter toute confrontation au titre de nos intérêts nationaux respectifs.
Notre relation inégale avec la Chine ne facilite pas les solutions de compromis, cette dernière ayant pris conscience de sa force mais elle ne peut pas ignorer que même si à court terme, le secteur des ressources naturelles est en panne, à plus long terme, le Canada reste un des grands dépositaires au monde des ressources les plus en demande. Nous ne ferons jamais de chantage car ce n’est pas notre mode d’action. Bien au contraire, étroitement lié aux États-Unis au plan de la sécurité, fidèle allié au sein de l’OTAN, fort d’une diaspora représentative des 192 pays du monde ou presque, nous serons ce que nous avons presque toujours été, à savoir, un partenaire fiable mais aussi fidèle à ses principes.